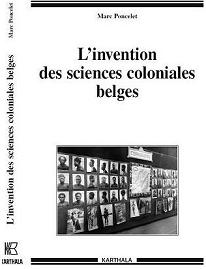
par Admin-Apad | 31 Mar 2015
Marc Poncelet – 2008 –
En Belgique, toutes les institutions contemporaines liées à la connaissance des mondes lointains trouvent leur origine dans l’expérience coloniale. La saisie savante et scientifique des mondes lointains et l’invention d’une vocation coloniale nationale, la construction d’une ambition impériale et finalement d’un pouvoir colonial doté d’une idéologie, bref de la « colonialité » belge, apparaissent donc inextricablement liées. Les sciences coloniales se sont d’emblée conçues à la fois comme connaissance de l’Afrique et comme analyse du processus colonial lui-même.
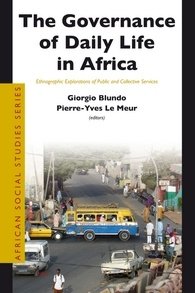
par Admin-Apad | 31 Mar 2015
Giorgio Blundo & Pierre-Yves Le Meur (eds.), 2009, The Governance of Daily Life in Africa: Ethnographic Explorations of Public and Collective Services, Brill Academic Pub.
Anchored in an empirically-grounded anthropology, this book explores the notion of governance in a non-normative way. It describes and analyses the institutional and political processes through which social actors and groups – be they state, private or « third-sector » – contribute to the provision of public and collective goods or services. The book draws on case studies from Anglophone and Francophone Africa, crossing anthropological traditions that have too often evolved in parallel directions and dealing with a range of topics such as health, water supply, sanitation and waste management, security, humanitarian aid, land issues and decentralisation. Beyond African boundaries, it contributes to current debates about governmentality, public policy, subject making, public/private boundaries, and the role of the state.

par Admin-Apad | 31 Mar 2015
Marion Fresia- 2009-
Quel sens donne t-on au « statut de réfugié » alors que l’on se trouve sur le territoire de ses ancêtres et de ses parents proches ? Comment les dispositifs d’aide humanitaire interfèrent-ils avec les mécanismes locaux de solidarité parentale et suscitent-ils l’émergence de nouvelles arènes du politique ? Quelles sont les implications du droit d’asile sur la redéfinition des critères de l’autochtonie et sur les modalités d’accès aux ressources locales ? Comment, enfin, se dessinent l’hétérogénéité des parcours, la complexité des mémoires du passé et la diversité des positionnements face à la question du retour chez soi ? A partir de ce cas d’étude, l’auteure s’interroge plus largement sur les usages sociaux, politiques et affectifs du statut de réfugié et des espaces humanitaires, et sur leurs conséquences en matière de transformations sociales.
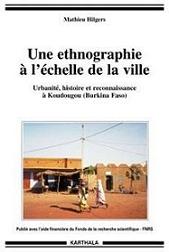
par Admin-Apad | 31 Mar 2015
Mathieu Hilgers- 2009-
Le livre ébauche un bilan de la littérature anthropologique consacrée à la ville en Afrique et esquisse une nouvelle anthropologie des villes moyennes. Elle se déploie à travers une étude de cas consacrée à la troisième ville du Burkina Faso : Koudougou. Son histoire tumultueuse et les manipulations politiques ont donné à cette agglomération la réputation d’être une ville rebelle. La position de la ville dans l’espace national reflète les transformations qui ont marqué le pays au cours du siècle. A travers l’analyse approfondie de trois représentations sociales – l’urbanité, l’autochtonie, la réputation de la ville – l’auteur engage une réflexion sur l’évolution socio-politique du Burkina Faso dont la portée concerne plus largement les villes moyennes de l’Afrique sub-saharienne.
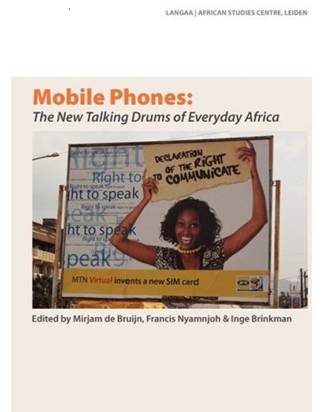
par Admin-Apad | 31 Mar 2015
Mirjam de Bruijn, Francis Nyamnjoh and Inge Brinkman -2009-
‘We cannot imagine life now without a mobile phone’ is a frequent comment when Africans are asked about mobile phones. They have become part and parcel of the communication landscape in many urban and rural areas of Africa and the growth of mobile telephony is amazing: from 1 in 50 people being users in 2000 to 1 in 3 in 2008. Such growth is impressive but it does not even begin to tell us about the many ways in which mobile phones are being appropriated by Africans and how they are transforming or are being transformed by society in Africa. This volume ventures into such appropriation and mutual shaping. Rich in theoretical innovation and empirical substantiation, it brings together reflections on developments around the mobile phone by scholars of six African countries (Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Mali, Sudan and Tanzania) who explore the economic, social and cultural contexts in which the mobile phone is being adopted, adapted and harnessed by mobile Africa.
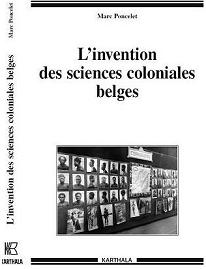


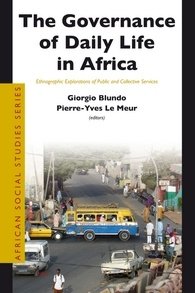

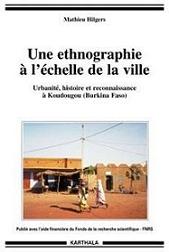
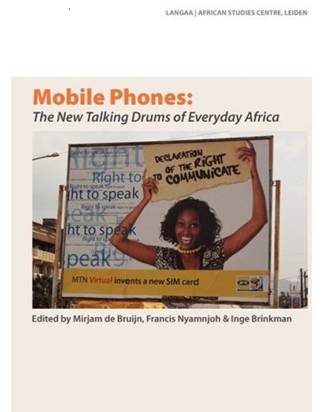
Recent Comments